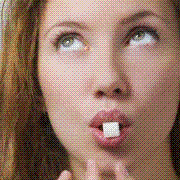Consommer trop de sucre est mauvais pour la santé, c’est un fait désormais bien documenté. L’excès de sucre, et notamment de boissons sucrées, augmente le risque de carie dentaire, de surpoids et d’obésité. L’abus de sucre serait aussi associé à une augmentation du risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires.
Mais qu’en est-il des liens entre consommation de sucre et cancer? Si cette relation est moins claire, de nombreux travaux de recherche sont en cours pour l’explorer, et leurs premiers résultats donnent à réfléchir. Que sait-on pour l’instant? Que reste-t-il à découvrir? Quels sucres sont concernés? Les édulcorants artificiels pourraient-ils constituer une alternative?
Glucides complexes ou sucres simples?
Les protéines, les lipides (les « graisses ») et les glucides (« les sucres ») constituent la majeure partie de nos apports énergétiques. Avec l’eau, ces trois familles d’éléments nutritifs représentent 98 % du poids des aliments que nous consommons, d’où leur appellation de « macronutriments ».
Le terme glucides recouvre non seulement les glucides complexes, apportés notamment sous forme d’amidon par les féculents tels que les pommes de terre, le riz ou les pâtes, mais aussi les sucres simples, plus couramment désignés sous le vocable de « sucres ». Ces sucres simples sont naturellement présents dans certains aliments, comme les fruits, principalement sous forme de fructose et les produits laitiers, sous forme de lactose et galactose. Ils peuvent aussi être ajoutés par le consommateur, le cuisinier ou l’industriel, sous forme de saccharose.
Pour déterminer l’impact d’un aliment sur le taux de sucre dans le sang, appelé glycémie, deux spécialistes en sciences nutritionnelles, David Jenkins et Tom Wolever, ont développé dans les années 1980 l’index glycémique. Il traduit la capacité d’un aliment à faire évoluer la glycémie dans les deux heures qui suivent son ingestion.
À partir de son index glycémique, on peut calculer la charge glycémique d’un aliment. Ce concept, élaboré à la fin des années 1990, correspond à l’impact qu’il aura sur le taux de sucre dans le sang, en fonction de la portion ingérée. Depuis, plusieurs études se sont intéressées au lien entre l’apport en sucres ou la charge glycémique et le risque de cancer.
Sucre, prise de poids, insuline et cancer
Certaines hypothèses soutiennent que le rôle des sucres simples dans l’apparition de certains cancers passerait par la prise de poids. En effet, des études ont permis d’établir des niveaux de preuve élevés entre la consommation de boissons sucrées, sources importantes de sucres simples et l’augmentation du risque de surpoids et d’obésité, le surpoids et l’obésité étant eux-mêmes des facteurs de risque connus pour différents cancers : cancers de l’œsophage, du pancréas, du foie, du sein après la ménopause, de l’endomètre, du rein et du cancer colorectal.
D’autres mécanismes pourraient toutefois également intervenir, même en l’absence de prise de poids. En effet, avoir une alimentation riche en sucres simples induit une production d’insuline importante, l’hormone régulatrice de la glycémie. Or l’insuline est un agent qui est dit « mitogène », c’est-à-dire qu’il peut favoriser la prolifération des cellules tumorales.
En 2018, le dernier rapport conjoint du World Cancer Research Fund et de l’American Institute for Cancer Research indiquait qu’une charge glycémique élevée de l’alimentation serait un facteur de risque probable pour le cancer de l’endomètre, la muqueuse qui tapisse l’intérieur de l’utérus à l’endroit où se déroule la grossesse.
Enfin, des études réalisées au sein de la cohorte NutriNet-Santé, sur + de 100,000 personnes, ont suggéré des associations entre la consommation de sucre simple, celle de boissons sucrées et produits sucrés ainsi que la charge glycémique et un risque accru de cancers, notamment de cancers du sein. Et ce, indépendamment de la prise de poids.
D’autres études sont néanmoins nécessaires pour approfondir ces résultats. Il est notamment nécessaire de déterminer les différences entre les types ou les sources de sucres et le risque de cancer. On peut en effet se demander si les sucres des fruits, des boissons sucrées, des produits laitiers ont tous le même effet sur la santé.
Limiter les apports en sucres simples
Étant donné ces potentiels effets délétères sur la santé, les organismes de santé publique recommandent de limiter ses apports en sucres simples. En France, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) préconise d’en consommer moins de 100 grammes par jour (hors lactose et galactose, qui sont présents dans le lait et les produits laitiers).
Il est également recommandé de limiter sa consommation de boissons sucrées, incluant les sodas et les jus de fruits, qui sont aussi riches en sucres que les sodas en moyenne, à une par jour au maximum.
On pourrait penser qu’une alternative serait de remplacer le sucre par des édulcorants artificiels. Mais cela pourrait ne pas être une solution idéale, car plusieurs études expérimentales et épidémiologiques suggèrent en effet de potentiels effets adverses de ces additifs alimentaires sur la santé.
Les édulcorants artificiels, une fausse bonne solution?
Les édulcorants artificiels sont des produits sucrants qui ne sont pas des glucides. Ils permettent de réduire la teneur en sucres ajoutés dans les aliments et boissons – ainsi que les calories qui y sont associées – tout en maintenant une saveur sucrée. L’aspartame (E951) ou l’acésulfame potassium (E950) comptent probablement parmi les plus connus de ces additifs alimentaires, qui sont aujourd’hui consommés chaque jour par des millions de consommateurs.
Présents dans des milliers de produits fabriqués par les industries agro-alimentaires, les édulcorants artificiels peuvent également être ajoutés ultérieurement dans les aliments, sous forme de « sucrettes » ou de poudres, par exemple.
Or, depuis quelques années, des données semblent indiquer que la consommation de ces produits pourrait ne pas être anodine. Ainsi, des études récentes menées dans le cadre de l’étude NutriNet-Santé (une étude de santé publique lancée en 2009 dans l’objectif de faire progresser les connaissances entre alimentation et santé) montrent une association entre la consommation d’édulcorants et un risque accru de cancers.
Il s’agit, au global, du cancer du sein, et de cancers « liés à l’obésité », autrement dit pour lesquels l’obésité est un des facteurs de risque : cancer du pancréas, du foie, du côlon-rectum, du sein après la ménopause, de l’endomètre, du rein, de l’œsophage, de la bouche, du larynx, du pharynx, de l’estomac, de la vésicule biliaire, des ovaires et de la prostate. Un risque accru de maladies cardiovasculaires a également été mis en évidence.
Au-delà de ces liens, il faut souligner que les autorités de santé ne recommandent pas les édulcorants, qui maintiennent l’appétence pour le goût sucré, comme une alternative sûre au sucre… Elles préconisent plutôt l’inverse, à savoir de tendre globalement vers une diminution du goût sucré dans notre alimentation. Du sucré, oui, mais avec modération, en somme…
auteurs
Mathilde Touvier - Directrice de l'Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, U1153 Inserm,Inra,Cnam, Université Sorbonne Paris Nord, Inserm
Charlotte Debras
de The Conversation